Chroniques de l’AstrOlabe
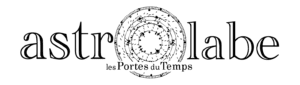
Les Chroniques de l’AstrOlabe, révélées uniquement aux contributeur.rices de la campagne de financement du projet —vous—, seront chaque mois constituées de deux volets : le premier décrira, sous forme de vidéo, de photos, de texte ou de pièce audio (selon l’humeur et les possibilités techniques), les avancées de mon travail autour de la création de l’exposition AstrOlabe. Le second vous dévoilera, chapitre après chapitre, l’histoire romancée des Portes du Temps.
CHRONIQUES #3 (1 OCTOBRE 2025)
CHAPITRE 2
Les voiles à croix rouges
*
Lorsque l’enfant reprend connaissance, autour d’elle tout a changé. Ce n’est plus le cirque et ses remparts à pic. Plus trace de rivières qui roulent des galets blancs ni de tortues géantes. Elle ne voit au-dessus d’elle que le ciel et des nuées d’oiseaux blancs qui hurlent dans les voiles. Car il y a des voiles couleur terre, et deux mâts très gros qui pointent les nuages hauts, et tout un enchevêtrement de cordages, de poulies qui claquent et des cordes tantôt lâches tantôt tendues comme les arcs des anges. Elle se redresse sur les coudes, regarde autour d’elle. Du bois, partout, des tonneaux, des types pâles, sales et affairés serrés dans ce qui a dû être à une autre époque des uniformes marins, devenus des haillons. Une chaleur moite, violente. Et le balancement constant, déroutant. Bien qu’elle ne voie nulle trace d’eau, l’iode la pénètre par bouffées. Étourdie par le roulement, elle se lève avec peine. Le navire fend les vagues. Les hommes sur le pont, frénétiques, brutaux et précis, vont et viennent, la frôlent et crient dans une lange inconnue et la bousculent mais nul ne la voient pas. Elle comprend la source de cette agitation car le bateau s’approche d’une côte. Terre infinie. Se tournant vers la poupe elle voit, sur le château arrière, près d’un marin qui tient le gouvernail, campé sur des jambes courtes, la barbe sombre et généreuse et la longue vue vissée à l’oeil, le capitaine de ce vaisseau. Deux autres navires du même type, aux voiles marquées de croix rouges et délavées, l’un plus petit que l’autre, accompagnent la caravelle. Et tout autour, s’avançant tel des oiseaux prudents, des dizaines d’embarcations primitives volent sur les crêtes d’écume, chargées de pêcheurs quasi nus à la peau noire et au crâne protégé par des bonnets de tissus. L’enfant s’interroge. Où est-elle donc ?
— Swahili, souffle une voix derrière elle.
Le rapace. Toujours lui
— Qu’est-ce que Swahili ?
— Un peuple, un monde, une culture. Sur une côte d’Afrique de l’Est.
— Je ne connais pas l’Afrique. C’est donc cela ? Pourquoi suis-je ici ?
— La machine que tu as réveillée semble avoir décidé de te faire visiter les âges et les continents, répond malicieusement l’oiseau.
— Tu disais qu’il fallait tourner les roues pour la faire fonctionner.
— Elles ont dû tourner pendant ton sommeil…
— Où est l’instrument ?
— Là-bas, dit l’oiseau en désignant du bec la fameuse boîte, posée à l’ombre d’une caisse en fer.
— Qui a donc actionné les roues ?
— Je ne sais. Mais nous voilà ici.
L’enfant se précipite vers la boîte, l’ouvre et en extrait le mystérieux instrument. Elle contemple la flèche de la roue de gauche. Celle-ci pointe vers l’inscription Mombasa. L’autre roue, elle, indique MCDXCVII
— Mombasa, qu’est-ce ?
L’oiseau tend l’aile vers la côte et une tâche blanche qui brille parmi des mille verts de la jungle équatoriale.
— C’est une ville ?
— Oui.
— Et qui sont ces hommes, ces bateaux qui nous transportent ?
— Des Chrétiens. Des Portugais pour être précis. Tu te trouves sur la caravelle d’un grand navigateur, celui qui a ouvert la voie vers les Indes à partir de l’Europe d’Occident, en contournant le continent Africain.
- Et eux ? Demande l’enfant en désignant les boutres qui escortent maintenant les trois vaisseaux vers le port.
À leurs bords, on distingue des visages ébahis et méfiants. Les dents blanches brillent dans le soleil, les corps vigoureux s’étirent pour voir par-dessus les vagues.
— Des Africains. Des Swahilis. Comprend leur étonnement, ils n’ont jamais vu de navire chrétien. Il faut une première fois à tout. Tu assistes à la rencontre de deux mondes.
— Vont-ils s’entendre ?
— Je ne le crois pas. Enfin, si, dans l’immédiat ils trouveront un terrain de négociation. Les Européens ne s’intéressent pas à l’Afrique. Pas encore du moins. Ils veulent des épices. Ils veulent aller aux Indes. Ils cherchent des pilotes, des marins familiers des mers de cette partie du monde, pour les aider à traverser vers leur destination.
Car nous sommes sur l’océan Indien. Enfin, à l’époque où nous sommes, il ne porte pas ce nom bien sûr.
— Bon. Et nous allons assister à cette rencontre ?
— À toi de voir. Le capitaine de cette expédition, l’homme que tu as vu tout à l’heure près du gouvernail, s’appelle Vasco de Gama.
— Je connais ce nom !
— Oui tu as dû en entendre parler à l’école. Il restera dans les mémoires. Il n’a pas fait que du bien autour de lui mais on ne peut pas lui retirer son courage. Regarde-le bien, et regarde encore cette Afrique préeuropéenne, car bientôt les Blancs y mettront pied pour la piller, et ne plus la quitter.
— Cela ressemble au paradis, murmura l’enfant, les coudes appuyés sur le bastingage.
Devant elle, nappés d’une brume légère, se distinguent les contours merveilleux d’une terre sauvage, brûlante et qui semble gorgée de richesses. À l’approche des navires étrangers, la petite ville aux murs tout blancs et plantée de mille arbres grouillants semble se mettre à vibrer. Des conques résonnent. On voit les gens se déverser dans les rues, courir des jardins vers les plages, quitter toute chose quotidienne pour se masser sur les terrasses et observer, bourdonnants, inquiets et fascinés, grandir ces voiles aux croix rouges venues de l’inconnu.
À suivre…
CHRONIQUES #2 (16 AVRIL 2025)
CHAPITRE 1
L’île d’il y a longtemps
*
L’oiseau a surgi de nulle part. Une minute plus tôt, l’enfant avait sorti l’objet de sa boîte, l’avait soupesé puis posé sur ses genoux. Il était épais de deux pouces, large comme un pied d’adulte. Il était fait de bois, renforcé à ses angles par des équerres de fer poli. Il devait être plein, car lorsqu’elle avait toqué de son index sur la tranche, aucun son n’avait résonné en dedans. Sur le dessus, deux roues crantées en cuivre, formant comme les montures de grosses lunettes rondes, occupaient la quasi-entièreté de la face. Elle l’avait retourné avec précaution. Dessous, le même sceau que sur la boîte en métal, avait été incrusté au feu. Le symbole représentait un disque cernée partiellement d’un croissant. On aurait dit la lune embrassant le soleil. La jeune fille avait remis l’objet à l’endroit, et s’était penchée sur les inscriptions qui, à intervalle de 30°, graduaient le périmètre de la roue de gauche. Indéchiffrables. Curieux glyphes, venus de loin sans doute, d’il y a longtemps, rehaussés ça et là d’accents et de ponctuations impossibles. Autour de l’autre roue, selon les mêmes intervalles, des chiffres romains. Pas d’ordre logique, un mystère complet. Elle hausse les épaules et saisit la petite poignée qui permet d’actionner la première roue. Mais celle-ci est bloquée. L’enfant force. Rien ne bouge. Elle secoue la machine de haut en bas, de gauche à droite, fronce les sourcils.
— Allez…
Elle tente à nouveau de tirer la poignée, perçoit que quelque chose cède. C’est à l’instant précis ou le mécanisme se met en rotation en grinçant, à la seconde même où la flèche qui saille de la roue se positionne en cliquetant sur l’inscription የዱር ደሴት et que sa jumelle se synchronise pour pointer, elle, sur le nombre —DCCCLXXXIII, qu’est apparu l’oiseau. Elle ne l’a pas entendu atterrir. Mais a-t-il seulement atterri ? Il est là, c’est tout. Devant elle, à cinq pas. Un grand rapace brun, aux plumes tachetées d’ivoire. Les yeux jaunes qui clignent. Les pupilles pleines de nuit. L’enfant n’en a jamais vu tel que celui-ci. Le vent est tombé, dans le champ d’à côté les cerfs-volants se sont posés en douceur, comme pour laisser place au maître des airs qui, d’un mouvement de bec, semble saluer.
L’enfant hésite, puis regarde l’instrument, comme pour l’interroger.
— Tu l’as retrouvé.
Elle relève brusquement la tête. L’oiseau a parlé. Ça ne peut être que lui. Elle serre un peu plus la machine entre ses bras, et il s’ébroue. Le bec s’ouvre et la voix, grave et calme :
— L’astrOlabe. Tu l’as retrouvé.
— Je…
— On n’a pas de temps à perdre, je t’expliquerai quand on arrivera.
— Quand on arrivera… où ?
Une lueur d’agacement passe dans les yeux de l’oiseau.
— Tu as retrouvé l’AstrOlabe. Et tu l’as activé. Il faut donc suivre sa voie.
L’enfant regarde autour d’elle, de peur que quelqu’un n’apparaisse sur le chemin et la surprenne à converser avec un animal. Tout semble absolument insensé.
— Es-tu prête ? reprend le rapace en déployant des ailes immenses qui découvrent un ciel d’orage.
Malgré elle, la fille acquiesce. Alors, d’un coup, tout devient blanc. Pendant une seconde elle ne sent rien de plus qu’une intense chaleur dans son corps, et la sensation d’être précipitée dans un manège inconnu. Sans limites ni forme. L’impression d’emprunter un passage entre deux mondes. Propulsée dans un espace infini, elle distingue à travers ses paupières closes des disques de lumière dont l’un grossit plus vite que les autres. S’en rapprochant, elle voit ce cercle brillant se muer en œil, l’œil du rapace. Sentant tout ce qu’elle a connu se dérober autour d’elle, elle se débat dans le néant et hurle de terreur comme lorsqu’elle se réveille, dans son lit trempé, d’un de ces cauchemars qui reviennent sans cesse.
Plus tard, lorsqu’elle essaierait de se souvenir de cet instant, elle ne saurait dire ce qui l’a d’abord frappé. La sensation de vitesse et le sifflement terrible dans ses oreilles ? La lumière crue du soleil ? Le vide sous ses pieds ? La beauté du décor qui s’étalait autour d’elle ? Ou le sentiment de sécurité inexplicable qui émanait du grand corps chaud du papangue —c’était le nom véritable du rapace— qui l’emportait sur son dos, surfant les airs cinq cent mètres au-dessus d’une jungle millénaire et d’un chaos de volcans effondrés.
L’oiseau plane, l’enfant posé sur lui, et décrit de larges cercles qui les rapprochent d’un balcon rocheux qui domine ce cirque étrange. Partout autour, des oiseaux. Le papangue se pose dans un bruit de plumes rassurant, la fille glisse de son dos. Elle sent sous ses sandales le feu des pierres noires.
Ils sont au bord d’un rempart vertigineux qui plonge dans un labyrinthe de pitons où grondent les torrents. Les parois grises s’accouplent aux branches. La forêt, grouillante, vivante, brisée par des ravins, arrosée de cascades, ne ressemble à aucune de celles que l’enfant connaît. Ni les arbres, dont les racines se fondent dans les rochers, ni les curieuses fougères géantes envahies d’insectes, rien de ce qu’elle voit n’est familier. Les odeurs mordent, la lumière frappe, éblouissante. Des perroquets verts, intrigués, viennent tournoyer autour d’eux en sifflant. Et puis, tout autour, à perte de vue, au-delà de ce qui paraît être une forêt-île dominée là-bas par des cratères sombres, la mer. Partout. L’enfant sent monter en elle une immense émotion, qu’elle est incapable de nommer.
Le rapace, enfin, parle :
— Tu as retrouvé cet instrument, et ce faisant tu as donné une chance à ton espèce de se souvenir et de voir plus loin.
— Je ne comprends pas.
— L’astrOlabe ouvre des portes, c’est tout ce que je peux te dire. Je ne sais comment il fonctionne, mais il te permet, à toi, de voyager de l’une à l’autre en actionnant les roues.
— Je ne sais même pas ce qu’il y a d’écrit dessus !
— Eh bien il faudra que tu te renseignes, chère amie, si toutefois tu veux aider ton espèce.
— Aider mon espèce ? Moi ? J’aime déjà pas trop ma famille, alors…
— Mais tu ne les laisserais pas tomber s’ils avaient besoin de toi. Et l’humanité, que tu le veuilles ou non, c’est aussi ta famille, non ?
— Pas faux.
— Viens, je vais te montrer quelque chose.
D’un coup d’aile, il jette l’enfant sur son dos et plonge dans le vide. Planant au ras des cimes, il atterrit bientôt dans une clairière où les cris des oiseaux saturent tout. La jeune fille glisse sur le sol. Elle lance des coups d’œil inquiets tout autour.
— Pas de panique. En ouvrant cette porte-ci, tu as bien choisi. Tu es en visite sur une île qui ne compte aucun grand prédateur. À part quelques araignées, rien ne te mangera. Cela ne sera pas toujours le cas… Mais regarde plutôt.
D’un sous-bois émerge, curieux autant que craintif, une sorte de grande oie aux plumes blanches et noires, au long cou et au magnifique bec doré. Il se déplace doucement, prenant garde à poser ses pattes griffues bien à plat, roulant de petits yeux farouches. Et tandis que ce curieux ibis se met à fouiller le sol, une énorme tortue s’avance à son tour, monumentale, balançant sa tête préhistorique en fourrageant dans les herbes, flattant la visiteuse d’un regard doux.
— Celle-ci est une cylindraspis Indica, la tortue géante. Et celui-là un threskiorns solitarius, ou solitaire de Bourbon. Ces espèces n’ont jamais existé en dehors de ce lieu. Malheureusement, d’ici quelques siècles, ils auront disparu.
— Pourquoi ? s’étonne l’enfant.
— Car les Hommes vont les chasser, les exploiter, puis les exterminer. C’est ainsi.
— Comment le sais-tu ?
— Parce que nous sommes dans un temps plus ancien que le tien. Et que j’ai vu l’avenir en venant te chercher.
— Hein ?
Le rapace tourne la tête vers l’enfant et désigne du bout de l’aile le ciel limpide et la lune qui y transparaît.
— L’astrOlabe permet de voyager dans l’espace. Et dans le temps.
La jeune fille se fige. Puis pâlit. Manque de tomber à genou. L’oiseau la soutient.
—Je sais. Mais il fallait bien que je te le dise, à la fin. Oui, tu es sur une petite île de l’océan Indien, que les humains finiront par nommer l’île de la Réunion. Mais le plus dur à croire, c’est que nous sommes près de 1000 ans avant ton ère.
À suivre…
CHRONIQUES #1 (17 FEVRIER 2025)
PROLOGUE
*
L’enfant emprunte la côte qui mène au promontoire. Courbée sous le poids d’un gros sac de toile, elle serre contre ses flancs deux masses informes. Sans les bobines de fil qui s’en échappent, les morceaux d’étoffe grossièrement pliés passeraient pour du linge de maison ou pire, pour de vulgaires chiffons. Parvenue au sommet, la jeune fille étale les pièces de tissu sur l’herbe et entreprend de les tendre sur des baguettes de bois. Cela fait, elle lance dans la brise le premier cerf-volant, le blanc, qui prend les courants et s’envole. Elle donne du large, ancre la ligne sous une roche puis se déplace de dix mètres et lâche l’autre cerf-volant, le noir, qui monte dans l’éther en frissonnant. Le voyant danser à trente mètres dans les airs, l’enfant cale la deuxième bride et, protégeant ses yeux du plat de la main, regarde le losange clair et le cercle sombre, leurs longues queues palpitantes, jouer devant le soleil leur ballet de serpents du ciel.
Elle retourne vers le cabas qu’elle avait posé là et en extrait une boîte de fer blanc qui fait la taille d’un gros livre, comme ceux à tranche marron et à lettres d’or qui vont par vingt dans les bibliothèques d’adultes et que personne ne lit jamais. Elle jette un regard alentour. Personne ne vient. Elle soulève lentement le couvercle.
Peut-être faut-il d’abord vous raconter comment cette cassette carrée, lourde comme une tuile, marquée d’une estampille aussi énigmatique que fascinante, s’est retrouvée entre les mains de cette enfant.
Le village, bâti à flanc de coteau, s’étire le long d’une rue unique depuis l’église, en bas, à la grande ferme des Ducs, là-haut. Les façades de pierre s’y succèdent dans la pente, cachent derrière les volets mi-clos des bouches sombres qui exhalent des odeurs de cave, de pomme, de savon, de viande bouillie. Tout en bas, plus bas que l’église et que l’épicerie, plus bas encore que le verger, court la rivière. C’est là que l’enfant l’a trouvé. En amont du lavoir, là où les lessives troublent l’eau, d’où l’on entend de loin, étouffé par les bosquets, le chant des lavandières. Les remous avaient chassé l’objet contre la berge, l’enfonçant jusqu’au couvercle dans la vase, l’entourant une fine écume qui le dissimulait presque entier et eut pu le faire passer pour une pierre de taille. Mais l’enfant, habituée à ces lieux et à toute chose qui y vivait, elle qui grandissait depuis son plus jeune âge les pieds dans le bouillonnement des ruisseaux, avait immédiatement distingué l’étrangeté de sa trouvaille. Sans hésiter, elle était descendue dans l’eau.
Jusqu’à ce matin où les cerfs-volants flottent au-dessus des toits rouges, la boîte avait dormi, close, dans le creux d’un vieil érable. L’enfant avait besoin d’outils pour en forcer la serrure. Cela devait prendre quelque temps. Attendre d’être seule. Attendre, encore, bon sang ! Mais la jeune fille avait la certitude, Dieu sait comment, qu’elle devait absolument être seule pour l’ouvrir. Maintenant, elle l’était, enfin.
Les yeux plissés, les mains tremblant d’excitation, elle bascule le couvercle dont le fer est poinçonné de deux ellipses, graduées et superposées. Un nuage masque soudain le soleil, lui fait lever la tête. Les deux cerfs-volants, dressés côte à côte à son aplomb, vibrent d’une énergie bizarre et glissent lentement l’un vers l’autre. L’enfant fronce les sourcils. Le cercle de toile noire se place exactement dans l’axe du losange blanc. Cela fait comme un œil terrifiant. Tout paraît s’obscurcir imperceptiblement. Mais la sensation ne dure qu’un instant. Le froid du métal sur ses cuisses rappelle l’enfant à la mystérieuse boîte, grande ouverte entre ses genoux. Elle penche le front, écarquille les yeux. Ce qu’elle découvre à l’intérieur la laisse d’abord profondément perplexe. Puis, lentement, prenant garde à ne pas endommager la chose, elle extrait de son écrin ce qui semble être un très ancien instrument de mesure.
À suivre…
